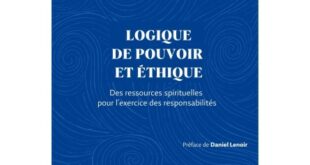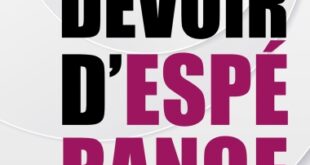Dans le livre L’Europe et ses défis, que Gérard Vernier, fin connaisseur de la commission européenne, et moi-même venons de publier aux éditions de l’Harmattan, nous cherchons à relever deux gageures : celle de raconter en 100 pages l’histoire de l’Europe, celle de présenter en 100 pages les principaux défis auxquels l’Union européenne est actuellement confrontée. Il s’agit donc d’un livre pédagogique et destiné à rester sur les rayons de nos bibliothèques. Nous ne sommes pas peu fiers qu’Alain Lamassoure, président de l’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe, l’ait salué comme une « magistrale synthèse ».
Au-delà de ces deux aspects, je souhaite approfondir la question de la puissance européenne au regard de ses sources spirituelles.
Comment définir l’identité européenne ? Lors de la table-ronde organisée le 25 avril dernier par six associations, dont Démocratie & Spiritualité, nous nous sommes interrogés sur les sources spirituelles de l’Europe. Nous avons tous en tête les débats liés à la controverse des années 1999-2000 au sujet de la rédaction du préambule de la Charte des droits fondamentaux autour du patrimoine « spirituel » ou « religieux » et repris en 2002-2003 à l’occasion des discussions sur le traité constitutionnel autour des racines chrétiennes de l’Europe. La formule finalement retenue est « S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles qui constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’Etat de droit ».
Philippe Gaudin nous a utilement rappelé les héritages grec et romain, ainsi que le socle majeur qu’avait constitué l’émergence de la Chrétienté. Chrétienté d’où nous provenons, selon ses termes, et que nous avons quittée mais dont nous restons influencés, qui s’est diffusée en nous en envahissant nos références, se seraient-elles sécularisées sous l’impact des Lumières. Gérard Haddad a de son côté souligné l’influence que les pensées et cultures juives et arabo-musulmanes ont eu dans le développement de notre civilisation européenne, selon des processus bien différents, allant jusqu’à s’interroger sur la notion d’une Europe gréco-abrahamique. La question n’est pas tranchée et demeure ouverte. Elle n’est pas sans conséquence.
D’un côté, on peut mettre l’accent sur la réalité de cet enracinement chrétien qui a marqué nos paysages et notre façon de penser, de peindre, de prier, d’agir. L’héritage est vivant au-delà même de ceux qui s’y réfèrent explicitement. Mais comment, dans ces conditions, ceux qui se sont éloignés de cette tradition ou qui ne l’ont jamais partagée, parce que venus d’autres horizons, pourront-ils se reconnaître dans les traits de cette Europe-là ? Quant à parler d’une Europe gréco-abrahamique, n’est-ce pas tirer un peu fort sur les concepts en faisant de la rencontre entre la synthèse gréco-romaine et la percée du monothéisme, en ces trois branches, le socle de notre vivre-ensemble ? On voit bien l’avantage, qui est d’insérer dans cette globalité tous ceux qui, aujourd’hui et quelle que soit leur origine, se retrouvent sur notre continent et pourraient dès lors se revendiquer de cette appartenance multiple et intégratrice. D’autant que l’histoire, à travers les colonisations et l’esclavage, a semé des graines d’appartenance qui se sont multiplié. Notre Europe a ensuite été balayée par le souffle de l’humanisme et la pensée positiviste qui a cru fonder notre abondance et notre bonheur dans la maîtrise des sciences et des techniques.
Comment regarder cette modernité technicienne qui donne à l’Europe son visage contemporain, visage qu’elle façonne depuis le 17ème siècle quand les Européens – et ce furent les seuls – comprirent que le code mathématique livrait les clés pour décrypter l’univers matériel et détricoter la nature ? On mesure la diversité de nos héritages qui tissent une mémoire vivante qui nous rend chacun, dans la spécificité de notre culture, membre de cette aventure collective. On mesure la capacité qu’ont eu les Européens, partant à l’aventure à travers les mers et les terres, d’absorber comme une éponge les cultures rencontrées et de les mettre en tension, devenant ainsi, au fil des siècles, des humains particuliers, mus par cette « inquiétude créatrice » dont a si bien parlé le grand historien Jean Delumeau. L’Europe a donné naissance à des marges qui l’ont dépassée, aux Etats-Unis, en Russie, en Australie, et diffusant une société universaliste qui s’est répandue sur l’ensemble de la planète, faisant de chaque homme et de chaque femme un « porteur d’un peu d’Occident en soi ». Où placer le curseur pour définir cette Europe insaisissable, qui se refuse à être géographiquement limitée, qui prend conscience d’elle-même au moment « où elle quitte », qui est un cheminement, une découverte, une interrogation et une auto-critique permanente ?
La question peut paraître très théorique. Elle le devient moins quand on croise cette réflexion avec la volonté qui se manifeste de plus en plus de transformer l’Union européenne en une Puissance. Gérard Vernier et moi-même nous sommes longuement interrogés sur cette notion. Nous l’avons finalement retenue comme sous-titre dans l’expression « Émergence d’une puissance continentale ». Mais la notion de puissance n’est pas simple, s’agissant de l’Europe. Comment en effet oublier que l’Europe a, par le passé, largement usé et abusé de la puissance, au point d’avoir été à l’origine du capitalisme et du communisme et d’avoir été l’élément déclencheur de deux Guerres mondiales. La montée d’un monde multipolaire, où chacun réarme, conduit à penser que l’Europe doit se doter d’une puissance militaire nécessaire pour se défendre et se faire respecter. Mais doit-elle entrer dans cette « montée en puissance » qui ne pourra aboutir, à un moment, qu’à une nouvelle confrontation, bien plus meurtrière que toutes les précédentes ?
C’est là que la diversité des sources spirituelles de l’Europe devient un enjeu d’actualité. Comment l’Europe se lit-elle ? Comme un club chrétien assiégé ? Comme un ensemble sécularisé et définitivement fâché avec tous ceux qui manifestent une « croyance » ? Comme une société laïque, ouverte à la richesse de chaque spiritualité ? Comme une société technicienne, reposant sur les sciences et les normes, et s’appuyant sur une bureaucratie ? A cette question s’en ajoute une autre, qui remonte des autres continents longtemps abaissés et humiliés par la morgue de l’Homme blanc, celle de la nature de l’universel. Y a-t-il un « universel européen» qui s’impose à l’ensemble de l’humanité ? Ou est-il concevable de réfléchir avec les autres peuples à un « universel de l’humanité » où chacun pourrait apporter sa propre approche de l’Homme ? Ne faut-il pas accepter cette éventualité à l’heure où les défis mondiaux (crise climatique, migrations, intelligence artificielle et risque de guerre totale) sont devenus si majeurs qu’il convoque l’humanité à sortir de ses querelles anachroniques et dévastatrices pour accéder à un niveau supérieur de l’Esprit et répondre, ensemble, à l’avènement d’une humanité enfin réconciliée ?
Dans ces conditions, nous voyons bien que cette nouvelle puissance européenne se doit de déjouer le piège de l’histoire. Oui, il nous faut nous défendre et nous faire respecter. Mais cette nouvelle puissance devra, plus que jamais, être mise au service de la paix, dans l’esprit qui a prévalu à la réconciliation franco-allemande et à l’émergence de cette Union fondée sur le droit, l’équité et la diversité. L’Union européenne doit réapprendre à habiter le tragique de l’Histoire mais l’humanité, confrontée à de terribles enjeux, a encore besoin d’une Europe forte et libre, a besoin des Européens.
 Démocratie & Spiritualité …une instance commune de réflexion invitant à l’action.
Démocratie & Spiritualité …une instance commune de réflexion invitant à l’action.