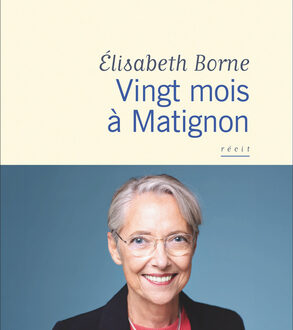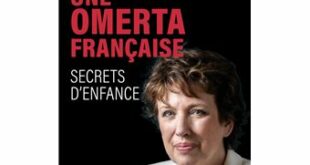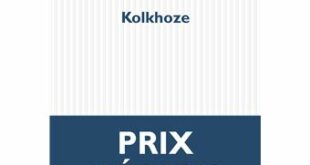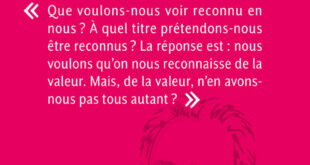Une lecture politique de Vingt mois à Matignon d’Elisabeth BORNE
Ed. Flammarion – 2024
D’une écriture simple et personnelle, Elisabeth Borne entrelace dans ce livre quatre faisceaux : d’une part sa vie personnelle, qui recoupe son enfance, son adolescence et les rumeurs sur sa sexualité, d’autre part, sa vie de femme publique, où elle montre du doigt un sexisme encore bien vivant et étonnamment plus sensible dans la vie publique que dans le secteur privé ; le rappel des lois importantes qu’elle a fait voter comme ministre puis en tant que Première ministre, avec notamment les débats houleux autour de la réforme des retraites (chapitre 13), de la loi immigration (chapitre 20) , et les raisons du recours au 49-3 pour le vote du budget ( chapitre 12) ; enfin, ses remarques sur le fonctionnement de notre pays et ses propositions pour l’améliorer.
Cet ouvrage constitue donc à la fois un récit personnel et une analyse politique.
Etrangement, la presse s’appesantit principalement sur ce qu’elle dévoile ou confirme de sa vie privée, en particulier le parcours de son père, juif d’origine russe, jamais vraiment revenu des camps de déportation, et suicidé quand la jeune Elisabeth avait 11 ans ; mais aussi sur la figure de sa mère, femme forte qui, devenue veuve au moment où l’entreprise familiale faisait faillite, affronta courageusement la vie et sut repartir en avant avec ses deux filles. Il est certain que ce contexte familial douloureux a forgé chez Elisabeth Borne un caractère d’airain. Ce qui n’exclut pas une vraie sensibilité, mais qui reste cachée. Ce n’est pas le moindre intérêt de ce livre que de lui avoir donné l’occasion de « fendre l’armure ».
Il n’en reste pas moins que l’analyse politique qu’elle fait de ces Vingt mois mérite qu’on s’y attarde.
D’abord le constat.
Dans Vingt mois à Matignon, Élisabeth Borne explore longuement les raisons du succès croissant du Rassemblement national (RN). Selon elle, (chapitre 18), le vote pour le RN s’explique en grande partie par un mécontentement vis-à-vis des partis traditionnels, le sentiment de déclassement économique et social et d’abandon, l’insatisfaction face aux politiques publiques actuelles, qui ne sont pas assez efficaces. Pour de nombreux électeurs, voter RN est un geste de rejet plutôt qu’un soutien idéologique ferme, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Le RN est une éponge à colère, qui sait mettre des mots sur les maux, sans pour autant proposer de bonnes solutions.
Autre point central du livre, la relation complexe entre la Première ministre et le Président de la République, Emmanuel Macron. Elisabeth Borne explique les raisons de son engagement derrière cet homme disruptif (p. 55-57). Elle décrit un rapport marqué par le respect mutuel mais aussi par des divergences de style. Elle, en tant que pragmatique attachée au compromis et au dialogue, se heurte parfois à un président qui écoute certes, mais décide de manière autonome, tout en étant sans cesse tenté de cumuler les fonctions.
Elle exprime également sa préoccupation face à la montée de partis comme le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI), qu’elle perçoit comme polarisant le débat public. Elle décrit à ce sujet les séances homériques à l’Assemblée nationale, la multiplication des motions de censure, la difficulté à trouver des accords, bien qu’elle soit parvenue à faire voter plus de 60 textes de loi grâce à des votes positifs. Elle pousse aussi un cri d’alarme face à la montée de l’antisémitisme favorisée par le jeu pervers entre ces deux partis.
Elle dresse enfin le tableau d’un pays « élitiste, corporatiste et jacobin » (p. 315).
Ensuite les propositions, qu’elle ne livre pas d’un bloc mais qu’elle distille au fil du récit.
Élisabeth Borne avance plusieurs propositions visant à transformer la gouvernance et réformer les institutions françaises, dans le but de renforcer la démocratie et d’apaiser les tensions politiques et sociales, ce qui est aujourd’hui un préalable pour avancer ensemble (p. 320). L’intérêt de son analyse est de considérer l’ensemble formé par le Président de la République, le Premier ministre et l’Assemblée nationale, qui a été déstabilisé par les différentes réformes de la Constitution de 1962 (élection au suffrage universel), et de 2000 (quinquennat suivi de l’inversion du calendrier des élections présidentielle et législative). Le Premier ministre joue un rôle de rotule qu’il convient de consolider, en rendant à la fonction présidentielle sa stature de garant et d’arbitre dans l’esprit de la Constitution de 1958, en valorisant le Premier ministre, enfin en modifiant le mode d’élection des députés.
Elle propose ainsi l’instauration d’un septennat non reconductible pour le président de la République. Elle souhaite également redéfinir le rôle du Premier ministre en lui confiant la présidence du conseil des ministres . Elle plaide enfin en faveur d’une réforme institutionnelle visant à instaurer un scrutin proportionnel au niveau départemental. Elle se déclare favorable à revenir en partie sur l’interdiction du cumul des mandats, afin que des élus territoriaux puissent siéger au parlement et y apporter leur sens des responsabilités et leur aptitude au compromis. Elle souhaiterait par ailleurs encadrer le droit de dissolution.
Sur la question du sexisme en politique, elle milite pour une meilleure représentativité en matière de genre et de diversité territoriale, notamment dans les exécutifs des collectivités territoriales.
Elisabeth Borne prône également une politique de dialogue et d’apaisement (chapitre 11). Elle rappelle les initiatives qui ont été prises, sans grand succès il est vrai, durant ces années (p. 149-150, et 236 : Grand débat, Conseil national de la Refondation, Conventions citoyennes, Dialogues de Bercy, Rencontres de Saint-Denis). Elle souligne l’importance des corps intermédiaires, tels que les syndicats et les associations, qu’elle considère comme essentiels pour représenter les citoyens et encourager une participation accrue dans la vie publique.
Enfin, elle propose de confier l’évaluation des politiques publiques au Parlement. A de nombreuses reprises en effet, elle s’insurge contre l’inefficacité des politiques publiques. Elle constate le manque d’indicateurs de suivi de l’action publique dont elle pouvait disposer en tant que Première ministre. En donnant au Parlement ce rôle d’évaluation, Elisabeth Borne espère renforcer la transparence et la redevabilité des politiques publiques, tout en impliquant davantage les députés dans le suivi et la mise en œuvre des réformes.
Elisabeth Borne est personnellement attachée au « dépassement » qui correspond à la recherche de solutions nouvelles au-delà des clivages politiques et idéologiques. Elle considère que le Bloc central (p. 270) est indispensable dans le panorama politique français actuel. S’appuyant sur son parcours personnel, l’ancienne pupille de la Nation veut donner à chacune, à chacun, les moyens de s’émanciper et de construire son propre chemin en s’appuyant sur le travail et la persévérance ; elle milite pour une éducation nationale attentive au rythme de chaque enfant (p. 315). L’ancienne préfète rappelle (p. 218) les mesures décidées pour améliorer la sécurité des Français après les émeutes urbaines. Celle qui a mis en place la Planification écologique défend un mode de vie empreint de sobriété (p. 312). L’ancienne Première ministre voit l’Europe comme une chance.
Autrement dit, Elisabeth Borne croit à une « société où chacun respecte l’ordre républicain et nos valeurs et bénéficie en retour de la promesse républicaine pour bâtir sa vie » (p. 311).
En somme, Vingt mois à Matignon est un témoignage riche d’évocations personnelles et de perspectives politiques, où Élisabeth Borne partage ses réussites, ses interrogations et ses projets.
 Démocratie & Spiritualité …une instance commune de réflexion invitant à l’action.
Démocratie & Spiritualité …une instance commune de réflexion invitant à l’action.